Histoire
Préhistoire
Le village de Reynès a une origine préhistorique avérée : de nombreux vestiges de cette époque ont été retrouvés au lieu-dit "Cova de la Dona". Ces vestiges datent d'une période relativement récente, entre -5000 et -2000 avant notre ère. Parmi eux, des fragments de poteries, une petite hache en pierre verte polie, des éléments de colliers et un poinçon en os poli.
Vers -1000, c’est l’époque de la civilisation mégalithique. Cette période fut également faste pour le territoire de la commune, puisqu'il subsiste encore de nos jours un dolmen. Au lieu-dit Camp d'en Seris, on a également retrouvé quelques vestiges du Néolithique tardif.
Antiquité
Durant l'époque romaine, le territoire de Reynès était traversé par la Via Vallespiriana, une voie de communication reliant la plaine à la station thermale d'Acquae Calidae (Arles). On dispose de peu de traces de cette époque, et quasiment aucune de celle qui suivit, lors des invasions barbares. Nous retrouvons donc les premiers Carolingiens vers l'an 800.
Époque féodale
C’est à l’époque carolingienne que les premières traces d’activité du village apparaissent. En 988, on trouve la première mention dans un acte de donation d'une vigne au monastère d'Arles. Comme bon nombre de villages, Reynès fut fortifié et protégé par un château construit au XIe siècle, aujourd’hui disparu. Bien qu’on ignore sa date précise de fondation, certains indices historiques éclairent son histoire. La première mention du château figure dans une charte datée entre 1088 et 1203, qui cite également le seigneur local "Petrus de Reiner".
À partir de 1111, le comté de Besalú fut intégré au comté de Barcelone (celui du Roussillon le sera en 1172, et celui de Cerdagne en 1177), entraînant un développement de Reynès durant le XIIe siècle, grâce à une relative période de paix. La population croît, multipliant les métairies sur les collines environnantes. La vigne et les oliviers sont les deux principales cultures, mais de nombreux champs produisaient également du blé. Pour le traitement, des moulins à eau furent construits le long du Tech.
Une mention plus précise du château apparaît en 1267 dans le testament de Guillem-Hug de Serrallonga qui, avant de partir en croisade, lègue à son épouse Gueralda le droit de jouissance du château de Reynès. Vers 1312, le château passe de la famille Serrallonga à celle des Rocaberti : Béatrix de Serrallonga hérite de son frère et, mariée à Dalmau VII, vicomte de Rocaberti et d'Urgell, le château intègre ainsi le patrimoine d'une des familles les plus influentes de l'Ampurdan.
Dans la première moitié du XIVe siècle, une période de crise débute, marquée par de mauvaises récoltes, des famines et des épidémies de peste. La population diminue, et beaucoup de mas sont abandonnés. À la fin du Moyen Âge, il ne restait plus que 14 mas sur les 70 que comptait la commune deux siècles plus tôt.
Reynès voit sa population croître à nouveau au XVIe siècle, notamment grâce à l’installation de Français traversant la frontière.
La seigneurie de Reynès était probablement tenue par une famille « historique », mais les traces font défaut, du moins jusqu’en 1600, où l’on retrouve un certain Alexis d'Albert qui accorde la construction d’une forge.
Traité des Pyrénées
À partir de 1630 commence la guerre de Trente Ans. Les Français s’opposent au roi d'Aragon pour des raisons purement politiques. La population locale est hostile à la France, mais c’est pourtant elle qui récupère les anciens comtés lors de la signature du traité des Pyrénées, en 1659.
En 1674, Louis XIV impose la gabelle, l’impôt sur le sel, aux comtés du Roussillon et de la Cerdagne. Très demandeurs de sel pour la chasse (le sel servant à conserver la viande), les habitants du Vallespir entrent en rébellion. Ce conflit entraîne une baisse démographique, due d’une part à un manque de naissances car les hommes étaient dans le maquis, et d’autre part au nombre de morts dans ce combat.
En 1702, un notaire de Céret tente, sans succès, de rédiger en français un inventaire des propriétés à Reynès. Malgré les progrès du français administratif au XVIIIe siècle, le catalan restera la langue écrite pour l’usage privé jusqu’au début du XIXe siècle.
Époque moderne
La commune de Reynès est officiellement déclarée à la Révolution française. Dès 1793, la guerre entre la France et l’Espagne fait baisser la population du village. Les habitants étaient plutôt favorables aux Espagnols, par réaction anti-française plus que par idéologie, puisque les deux camps avaient tenté d’effacer la spécificité catalane.
À la fin du XIXe siècle arrive le train dans le Vallespir. Bien plus qu’un simple moyen de locomotion, comme aujourd’hui, le train était alors un véritable lien entre la ville principale, Perpignan, et les villages de la vallée. À Reynès, fut construit le Pont Neuf, de type Eiffel, en 1883. Il servit jusqu’en 1965, année de l’arrêt d’exploitation de la ligne. Depuis peu, il est réservé aux cyclistes et piétons. Il est surmonté des vestiges de voies ferrées, marquées par des traces de balles datant de la Seconde Guerre mondiale.
En montant vers le château, à mi-chemin, on peut observer au sol les vestiges d’un bâtiment partiellement creusé dans la roche. Il s’agit probablement des ruines de l’église Saint-Vincent, mentionnée pour la première fois en 1027 dans un acte de donation. Elle fut abandonnée après la construction de l’église actuelle, érigée entre 1698 et 1712. Les bases des murailles du château entourent le sommet du promontoire, où l’on devine les fondations d’une tour côté nord. Des fouilles archéologiques réalisées en 2018 ont montré que cette base de tour est plus ancienne que les remparts eux-mêmes. Les recherches révèlent également que le château semble avoir été abandonné entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle.













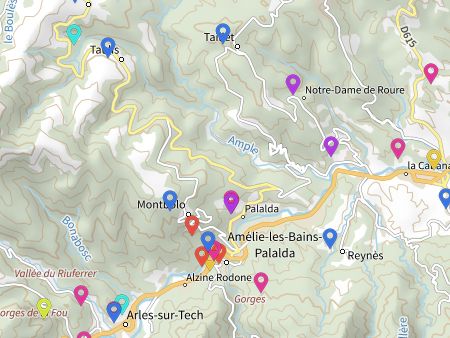
 Les Pyrénées-Orientales
Les Pyrénées-Orientales